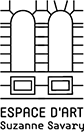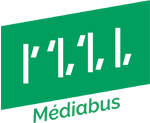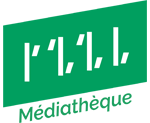Garche - Koeking

Les élus
Brigitte SCHNEIDER
La population de Koeking
Les mêmes sources, nous permettent de suivre l’évolution tout aussi négative à Koeking. 1473 : 14 feux, puis en 1495 et 1501: 12 feux. La population baisse à 9 feux en 1525, à 8,5 feux en 1528 et à 8 feux en 1537. La chute de population est moins forte qu’à Garche, mais nous passons de 70 habitants à 40 entre 1473 et 1537. Puis la population remonte en 1561 avec 16 foyers, soit environ 80 habitants". En 1604, 7 foyers sont recensés par la prévôté de Thionville, soit environ 35 personnes"‘. Après la guerre de Trente Ans, la population augmente à nouveau. En 1692, Koeking compte 13 foyers. En 1728 une réclamation adressée à l’Évêque de Metz mentionne 24 ou 25 ménages pour Koeking (soit 120 à 125 personnes).À la fin du XVIIème siècle, Koeking compte 299 habitants (soit 60 ménages).
En 1831. Koeking compte 346 habitants, et Garche 452. En 1834, Garche compte 447 habitants et Kceking 346. La population était estimée lors des nominations des maires. Ainsi en 1837, l’ensemble de la commune de Garche (c’est-à-dire avec Koeking) compte 855 habitants. En 1844, l’ensemble des deux villages compte 834 habitants. En 1846, lors de la nomination du conseil municipal la population totale de Garche est estimée à 827 personnes. En 1856, Koeking compte 325 habitants, et 357 en 1858.
À partir de 1866, la population de Garche et Koeking est estimée à 894 habitants.
Nous observons ainsi l’augmentation progressive et lente de la population des deux villages.
Le nombre d’habitants de Garche est bien connu pour l’année 1895. Ainsi pour Garche et Koeking, on compte au 2 décembre 1895 183 maisons habitées, 192 foyers composés de 358 hommes et 382 femmes, soit 740 personnes.
Au niveau religieux, elles se répartissent en 722 catholiques, 11 protestants et 7 juifs.
720 personnes sont nées en Alsace-Lorraine, 10 sont originaires d’états allemands, 4 de France et 6 d’ailleurs. Parmi les 720 personnes nées en Alsace Lorraine, 628 sont nées dans la commune, 2 dans le Bas Rhin et 95 en Moselle.
Grâce aux relevés des registres paroissiaux de Husange, nous pouvons suivre l’évolution de la population pour Koeking - Husange, à savoir 310 en 1900, 318 en 1905 et 328 en 1910.
De même pour Garche, les mêmes relevés donnent une population de 500 personnes en 1900, 488 en 1905 et 531 en 1910. En 10 ans, la population globale de Garche-Koeking-Husange s’accroît de 46 habitants, soit une progression de 5,7 %.
Ensuite, la population de Koeking reste stable jusqu’à la veille de la première guerre mondiale (328 en 1914). Après guerre, on note une chute (316 en 1924) du fait de la guerre, puis une progression jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale (1938 : 330 habitants) où l’on retrouve le niveau de 1914.
Pour Garche, on observe le même phénomène de croissance jusqu’en 1914 (546 habitants). La chute à la sortie de la guerre n’est guère marquée (1921 : 543 habitants). Et c’est plutôt une stabilité qui règne jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale (548 habitants en 1938).
La population, lors des élections municipales de 1929 est estimée à 550 habitants pour Garche et à 295 habitants pour Koeking. Lors du recensement de 1931, la population s’élève à 545 habitants pour Garche et à 311 habitants pour Koeking. À travers le recensement de 1936, nous apprenons que Garche comptait 566 habitants répartis en 139 ménages et 138 maisons.
Après la seconde guerre mondiale, Koeking voit sa population diminuer (1945 : 257 habitants) pour ensuite se stabiliser jusqu’au rattachement à Thionville en 1970 avec 246 habitants. Lors du recensement général de 1982, Koeking ne compte plus que 224 habitants.
Pour Garche, la population reste stable à la sortie de la seconde guerre mondiale jusqu’en 1955 avec environ 560 habitants. La construction d’une importante cité fait grimper la population à 860 en 1956, plus de 1000 en 1960, puis 1100 l’année suivante et 1200 environ à partir de 1965. Au rattachement à Thionville en 1970, Garche compte 1244 habitants. Le recensement de 1982 n’en dénombre plus que 1070.
Les seigneurs de Koeking
En 1380, Gilles IV de Rodemack vend plusieurs villages dont Koeking à Schwager Gaucher de Chatillon pour 1100 florins de Mayence.
Les Augustins de Thionville possèdent aussi des biens à Koeking et ce dès le XIVe siècle. En 1418, Niclaus Marschulek, échevin de Thionville, a fondé deux messes au couvent des Augustins de Thionville par une rente de seigle à prendre sur le ban de Koeking et de Guentrange. Les Augustins avaient aussi une cense (importante ferme) à Cattenom et à Koeking. En 1446, une rente de 8 maldres de seigle sur les biens des Chevaliers de l’ordre teutonique appelée donation Stourm est perçue à Koeking.
Ces faits confirment la tradition qui conserve à Koeking le souvenir des chevaliers du Temple, qui chaque soir à l’angélus venaient un flambeau à la main sur les bords de la Moselle et répondaient par des signes de croix aux chevaliers de Mailing, situés sur l’autre rive. Une commanderie des chevaliers de l’Ordre Teutonique existait donc à Koeking au XVème siècle
En 1558, Thionville, après le siège mené par le duc de Guise, passe sous l’autorité du roi de France, pour être vendue à Philippe II, roi d’Espagne en échange de Saint Quentin. Le Couvent des Augustins fut employé dans les fortifications de la ville après avoir été ruiné en partie par le siège.
Les religieux ayant quitté Thionville, les magistrats et échevins de Thionville s’emparèrent des revenus des Augustins pour les appliquer au profit des pauvres de l’hôpital. Éprouvant des difficultés pour percevoir ces rentes auprès des débiteurs du Couvent des Augustins, les magistrats de Thionville demandèrent l’appui du roi d’Espagne, qui leur fut accordé en 1564.
Au retour des Augustins en 1612, ils récupérèrent la jouissance de leurs biens et il est à noter que durant leurs absences les chevaliers de l’ordre teutonique avaient toujours réglé les rentes dues depuis 1558.... ce qui n’avait pas été le cas pour beaucoup d’autres débiteurs du couvent.
Pour autant les relations se détériorèrent quand les Augustins voulurent rétablir la rente à son montant d’origine c’est à dire 8 maldres de seigle, au lieu des 3 ½ maldres de seigle et 3 ½ maldres d’avoine payés depuis 1565 environ, c’est-à-dire durant l’administration des biens par les magistrats et les échevins de Thionville.
Une dispute de plusieurs années tout au long du XVIIème siècle s’en suivit avec le Commandeur de la commanderie nommé Lotharius Braun, ainsi qu’avec le Sieur Vincent Vary du Fort, Commandeur de la Commanderie de Luxembourg, appelée Commanderie de Beckingen.
Ces procès permettent de souligner l’importance que revêtait la possession de titres ou de rentes écrites. Or ici en l’occurrence, les Augustins avaient perdu tous leurs papiers dans l’incendie de leur couvent en 1558. Ils ne pouvaient s’appuyer que sur des témoignages et des pratiques ancestrales, non sur des écrits.
Le couvent des Augustins continua de développer ses possessions à Koeking, notamment le 28 novembre 1722 par l’acquisition de biens appartenant à Jean Probst, Barthel et Antoine Stefen, puis le 5 avril 1727 où Jean Probst, Dominique Barthel et Antoine Stefen se virent obligés de vendre divers immeubles pour rembourser les 50 dalers que les Augustins avaient prêtés au nom de Arnoud de Guénange à Marguerite Sturm de Koeking, leur ancêtre, le 19 juillet 1636.
L’ensemble des possessions des Augustins tant à Garche, qu’à Koeking et ailleurs est repris dans une déclaration de 1739.
Par ces péripéties du couvent des Augustins de Thionville, nous apprenons aussi que Koeking abritait une censé de la commanderie des chevaliers teutoniques, au moins à partir du XVIème siècle.
À travers le dénombrement de la Seigneurie de Cattenom du 19 octobre 1706 effectué par Jean François Wolter de Neurbourg, nous constatons que l’ensemble du village de Koeking est soumis au Seigneur de Cattenom en ce qui concerne la haute, moyenne et basse justice. Déjà le dénombrement du 22 mai 1681, effectué par Jean baron de Fléron, Seigneur de Meslin, Caremberg et Cattenom cite aussi pour Koeking la haute, moyenne et basse justice. Le 27 février 1763, une ordonnance de saisie des biens et droits seigneuriaux des de Wolter et Seigneur de Neurbourg est rendue en application d’un contrat non honoré par Benoît Nicolas de Wolter.
La chapelle Sainte Lucie à Kœking
Le village de Koeking étant dépourvu de chapelle, au XVIIème siècle, on songea à construire un édifice religieux. Les tourments de la guerre de Trente Ans s’étaient apaisés, il était à nouveau possible d’envisager l’avenir.
La chapelle Sainte Lucie de Koeking a été construite en 1678-1679, par Jean Kollen et Marc Terver à leurs frais. Le 26 avril 1679 un contrat est passé devant S. Bahr et B. Fourm, notaires royaux à Thionville par lequel les initiateurs du projet s’engagent à entretenir le bâtiment ; Pierre Hettinger au nom de la communauté de Koeking s’engage à payer annuellement au curé de la paroisse de Husange, dont Koeking faisait partie, un pichet de blé par ménage habitant Kceking. En contre partie, le prêtre s’engage à célébrer une messe par semaine dans la chapelle.
L’approbation et la bénédiction de Monseigneur Georges d’Aubusson, Évêque de Metz étant accordées le 29 avril 1679, Maurice Schlecht, curé de Husange, put procéder à la bénédiction de la chapelle sous le vocable de Sainte Lucie.
Le 18 avril 1700 un nouveau contrat définit la rétribution du prêtre pour assurer la messe hebdomadaire à la chapelle Sainte Lucie. La communauté s’engage à verser un pichet de froment par ménage et un demi pichet pour les « gendres qui demeurent et ne font qu’un pot avec leur père et mère », le versement se faisant à la Saint Martin d’hiver (soit le 11 novembre).
On apprend, ensuite que la chapelle est interdite au culte le 21 janvier 1804 par Monseigneur Pierre François Bienaymé, Évêque de Metz. Cet interdit sera levé le 23 décembre 1805 par ce même évêque sur la requête du Conseil Municipal de Koeking.
L’entretien de la chapelle fut négligé durant la seconde moitié du XIXème siècle. L’état de délabrement et le danger qu’elle présentait furent à l’origine, en 1906, d’une ordonnance du Kreisdirektor (l’équivalent du sous-préfet) exigeant la destruction pure et simple ou la réparation du bâtiment. L’abbé Martin, curé de la paroisse de Garche - Husange, opta pour une restauration et il organisa une première collecte en 1906 qui rapporta 849 marks. 600 marks furent utilisés pour la maçonnerie, la toiture et le plafond. Le reste (249 marks) fut placé sur un livret de la Caisse Raiffeisen de Garche (actuelle Caisse de Crédit Mutuel).
A l’occasion de ces travaux on récupéra les pierres du chœur de l’église de Garche pour en faire le dallage de la chapelle. On trouva aussi une couronne d’argent sur les vieilles statues délabrées. Elle fut, à cause de sa valeur et de son travail ouvragé, déposée dans l’église de Garche où elle couronnait la statue de la Vierge. Cette couronne avait été rachetée par le Conseil de Fabrique de Garche pour la somme de 20 marks. Les bancs furent fournis par M. Léonard, menuisier de Koeking, la pierre de l’autel provenait de l’église de Berg-Gavisse.
Après une visite de l’Archiprêtre qui jugeait la chapelle convenable pour l’exercice du culte, l’abbé Martin s’adressa à l’Évêque de Metz pour obtenir la permission de bénir à nouveau la chapelle Sainte Lucie et d’y dire la messe une fois l’an ainsi que pendant les inondations qui empêchaient les fidèles d’assister aux offices à Garche ou à Husange. La demande fut accordée le 7 décembre 1910, et le 13 décembre 1910 l’abbé Martin procéda à la bénédiction de la chapelle en la fête de Sainte Lucie.
Après 1930, la construction de la nouvelle Mairie-Ecole aboutit à la destruction de la chapelle. Un petit oratoire rappelle l’ancien emplacement de la chapelle.
Mairie de Quartier
131 rue de Meilbourg
Tél : 03 82 53 29 58
Les lundis et jeudis de 12h à 19 h
Les mardis et mercredis de 8h à 12 h et de 14h à 17 h
Les vendredis de 8h à 15h